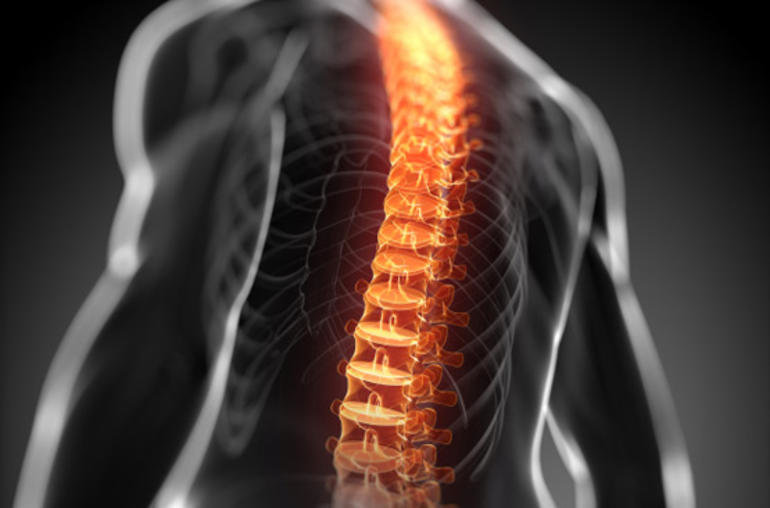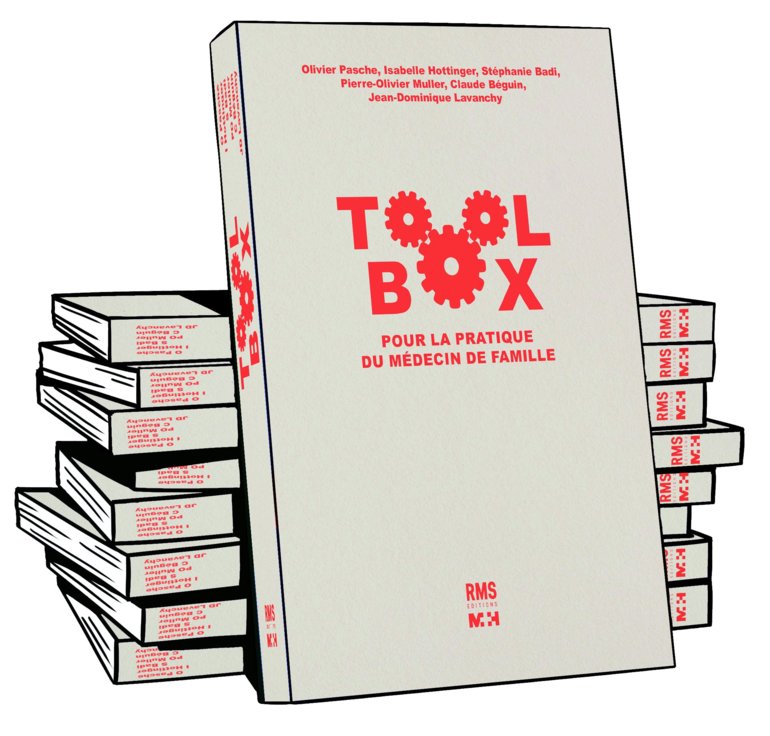Les coûts de la santé continuent d’augmenter de manière exponentielle. Le vieillissement de la population ne cesse de remplir nos hôpitaux. Pour pallier cette situation alarmante, certains estiment avoir trouvé la solution idéale: le « virage ambulatoire ». Éric Bonvin plaide plutôt pour une refonte de tout le système de santé. Interview.
Pour pouvoir continuer à hospitaliser autant qu’aujourd’hui, il faudrait doubler le nombre d’hôpitaux en Suisse d’ici 30 à 40 ans. Allons-nous droit dans le mur ?
Pr Éric Bonvin - Nous sommes en effet dans une impasse. Depuis les années 70, on a considéré que l’hôpital devait être géré comme une industrie de production de ce produit étrange qu’est l’assemblage d’une pathologie avec une prestation de soin. Conséquence: aujourd’hui, chacun fonctionne à l’aveugle en essayant de produire plus pour rapporter plus, en perdant de vue la trajectoire de soin du patient et le soulagement qu’il est en droit d’attendre. Personnellement, ce n’est donc pas tant l’évolution du nombre d’hospitalisations qui m’inquiète. Le problème, c’est surtout ce système qui nous pousse à faire des actions rentables mais de plus en plus inutiles. Actuellement, environ une intervention médicale sur cinq est superflue. Et tout ceci au détriment du patient, malheureusement.
Le virage vers l’ambulatoire ne contribuerait-il pas à réduire les coûts ?
Cela dépend de ce que l’on entend par « virage ambulatoire ». Il a du sens uniquement si on change de point de vue et qu’on ne travaille plus chacun pour soi. Il y a une nécessité urgente de créer plus de liens entre les milieux ambulatoires, hospitaliers, la prévention, etc. C’est donc un faux problème de parler uniquement de ce virage. Si le système continue d’être morcelé ainsi, le problème des coûts sera tout simplement déplacé vers le domaine ambulatoire.
Dans ce cas, est-ce vraiment à l’hôpital de développer l’ambulatoire ou faut-il miser sur des structures intermédiaires, comme les EMS ou les instituts de soins à domicile par exemple ?
C’est évident que l’hôpital ne doit plus être une forteresse, mais un maillon de la chaîne. Un séjour hospitalier doit se faire en lien avec l’avant et l’après, ce qui induit plus de prévention et un meilleur suivi tout au long du parcours de soins du patient. Par ailleurs, l’hôpital doit également pouvoir assurer une activité subsidiaire dans les domaines ambulatoire, de la prévention des maladies et de la promotion de la santé.
Le personnel de ces structures intermédiaires est déjà surchargé. Comment ne pas faire couler le bateau ?
Il faut décloisonner le système, y mettre les moyens en circulation et les mutualiser. Aujourd’hui, en plus de jouer le rôle d’une forteresse, l’hôpital est aussi un coffre-fort. C’est lui qui amasse une grande partie du budget global de la santé. Nous devons donc mettre ces ressources en circulation pour sortir de cette logique d’économie de marché où nous sommes en concurrence les uns avec les autres. C’est vrai que les structures intermédiaires sont coûteuses en ressources humaines, mais ce sont pourtant bien elles qui soignent et on ne va pas faire de la santé uniquement avec des robots.
Les nouvelles technologies, justement, peuvent-elles jouer un rôle dans l’évolution du système de santé ?
C’est très bien si les robots nous aident un peu, sans toutefois prendre le dessus. Les technologies doivent nous servir, pas prendre la place de l’humain. Il faut absolument éviter d’être asservi par la machine. Notre système doit maintenant intégrer le fait qu’investir dans le personnel est la meilleure garantie de sécurité et de qualité.
En Valais, quels sont vos projets concrets pour faire évoluer le système ?
L’hôpital est totalement sous le contrôle des politiques. Lorsque nous prenons une décision, le gouvernement peut toujours dire « non ». Nous n’avons donc quasiment aucune marge de manœuvre. La seule possible se situe peut-être au niveau du terrain, où nous travaillons à favoriser les relations entre les hôpitaux, les médecins de ville et les autres institutions de soins tout en défendant la qualité de la relation entre tous les acteurs, y compris bien sûr le patient.
Ce changement de mentalité ne devrait-il pas intervenir plus tôt dans la formation initiale des médecins ?
Oui, d’ailleurs des choses se construisent déjà dans ce sens. Au cours de leur formation, les jeunes médecins sont mieux sensibilisés à l’inter-professionnalité. Ils sont habitués à collaborer avec les autres métiers du monde médical. Je constate que ma génération est plus individualiste. Les jeunes, en revanche, comprennent que ça ne sert à rien de cumuler des heures d’activités administratives. Ils préfèrent donc travailler efficacement en collaboration, dans les cabinets de groupe par exemple. C’est une bonne chose, car le travail en réseau stimule la créativité.
Vous êtes l’un des rares médecins à diriger un hôpital en Suisse romande. Un profil en voie de disparition ?
Il semblerait oui… Aujourd’hui, les professions médicales sont de plus en plus subordonnées au monde de la gestion et de la politique. A mon sens, c’est préoccupant, car c’est aussi le signe que les soignants se désintéressent de la politique sanitaire. Moi, j’aimerais voir des jeunes médecins motivés à discuter de problématiques de santé publique, qui cherchent des solutions pour répondre aux besoins sanitaires de la population, éviter les interventions inutiles et pour amener plus de solidarité dans le système.


 Médecins de garde
Médecins de garde
 Infographies patients
Infographies patients