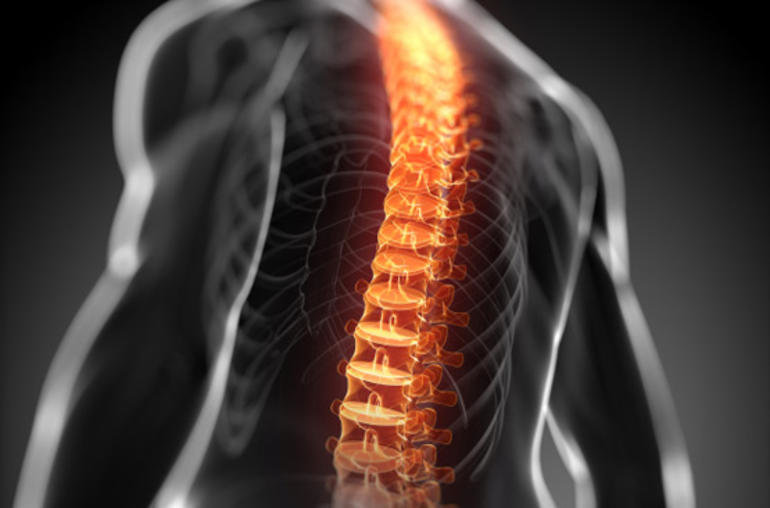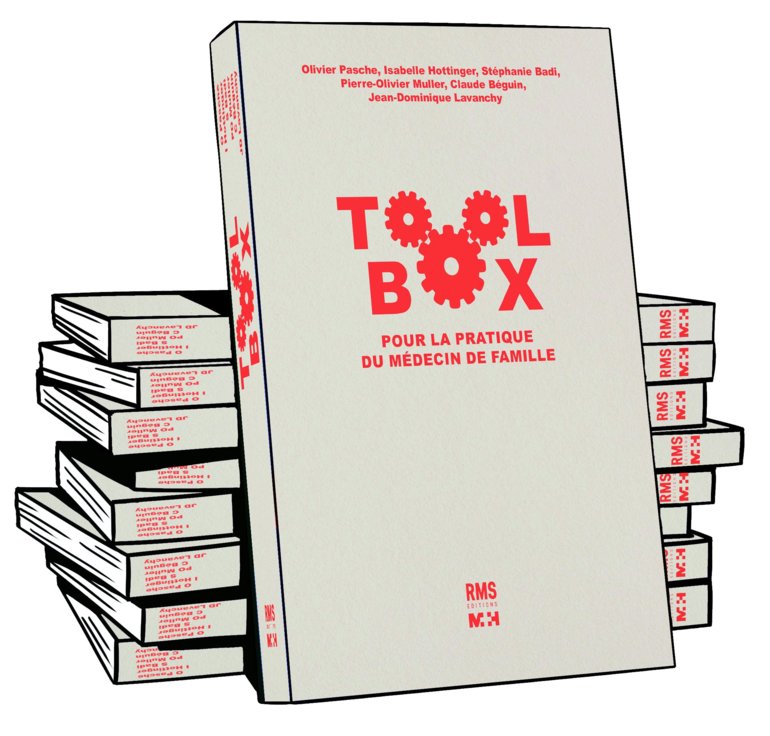Parler des droits des patients avec des médecins conduit parfois à des réactions critiques. Il y a ceux qui regrettent que l’on ne parle pas plus des devoirs des patients et des droits des professionnels de la santé. D’autres s’inquiètent de la pression que cela entraîne sur les médecins avec pour corollaire le développement d’une médecine défensive. Enfin, il y a les nostalgiques du paternalisme médical qui défendent que c’était mieux avant et que, de toute manière, les patients n’y comprennent pas grand-chose. Certes, nombreux sont aussi les médecins qui ont intégré les droits des patients dans leur pratique quotidienne, qui s’appuient dessus plutôt que s’y opposent. Depuis les années nonante, les étudiants en médecine sont formés aux questions éthiques et juridiques, une part belle de cet enseignement portant sur les droits des patients, avec notamment des aspects de psychologie médicale, d’anthropologie, de sociologie et de communications. Les futurs médecins sont préparés dès le début à vivre une relation avec leurs patients basée sur une écoute active et le souci de répondre au mieux non seulement à leur besoin de santé, mais également à leurs attentes. Le droit à l’autodétermination, le respect de la confidentialité, la protection des données, le droit d’accès aux soins et le droit à la santé sont autant d’éléments qui rythment la pratique médicale et qui guident médecins et patients tout au long de la prise en charge.
Formellement, les droits des patients font leur apparition dans la législation cantonale à partir des années huitante, la loi vaudoise sur la santé étant la première en 1985 à inclure un chapitre sur la question, suivie en 1995 par la loi de santé neuchâteloise. Pourtant, ils sont largement antérieurs à cette introduction au niveau législatif cantonal. La jurisprudence aborde depuis les années septante des questions portant sur les droits des patients, que ce soit en matière de consentement, de responsabilité médicale, de secret professionnel, de transplantation ou de décision en début ou en fin de vie. Mais leur origine est encore plus ancienne, les tribunaux devant bien pouvoir s’appuyer sur des bases légales pour rendre leurs décisions. Les droits des patients au sens étroit peuvent se définir comme l’ensemble de nos droits de la personnalité, à savoir les droits qui nous appartiennent du simple fait de notre existence, appliqués dans le domaine de la santé. Sous cet angle, ils reposent sur les premières dispositions du Code civil suisse portant sur les droits de la personne et le droit de la famille qui règle aussi les questions de représentation. En passant, le Code civil suisse date de 1905 et est entré en vigueur en 1912. Même si les dispositions sur les droits de la personnalité ont évolué depuis, on ne peut affirmer qu’ils soient vraiment nouveaux, surtout sur les principes. Le Code pénal, adopté en 1937 et entré en vigueur en 1942, comprend aussi des articles importants qui protègent la vie, l’intégrité corporelle, l’image, la sphère privée, autant d’éléments qui relèvent aussi des droits des patients. Enfin, les patients disposent aussi de droits fondamentaux consacrés par la Constitution fédérale. L’ensemble de ces normes existaient longtemps avant l’adoption des dispositions dans les législations sanitaires cantonales.
A ce titre, il peut paraître surprenant que ces droits ne soient pas toujours bien compris par les médecins eux-mêmes. Déjà en 1986, Olivier Guillod plaidait dans sa thèse de doctorat pour le passage du paternalisme médical à l’autodétermination des patients en proposant une meilleure prise en compte de la règle du consentement libre, exprès et éclairé des patients . En droit, il s’agit du premier motif justificatif à tout acte médical, considéré a priori comme une atteinte aux droits de la personnalité. Vu sous cet angle, le consentement peut apparaître comme une remise en cause de la diligence et de la compétence des médecins. Il est en effet choquant qu’un traitement puisse être interprété comme une atteinte à l’intégrité alors que le médecin souhaite avant tout soigner ses patients et soulager leurs souffrances. « Celui qui traite le patient ne le maltraite pas », comme affirmait Karl Stooss en 1886. Le consentement est effectivement plus qu’un simple motif justificatif. Il est une marque de respect mutuel, l’occasion d’un dialogue, la condition d’une prise de décision en commun chacun apportant, dans la mesure de ses moyens, ses propres compétences et connaissances. Aujourd’hui, les médecins sont sans doute mieux formés pour respecter cette règle en communiquant ouvertement et sans pression le diagnostic, l’ensemble des enjeux d’un traitement et de ses alternatives, y compris l’absence de traitement, les risques et les bénéfices, le pronostic mais aussi les questions de frais et de remboursement.
Plusieurs éléments expliquent peut-être les réticences et les difficultés exprimées par certains médecins face aux droits des patients. Il peut exister un malaise de leur part de devoir partager des informations, donner la parole, respecter la décision du patient, alors que le médecin détient un savoir et une expérience qui dépassent largement les compétences (du moins scientifiques et techniques) dudit patient. Cela remet en cause son autorité et peut le déstabiliser. De plus, même s’il aide à encadrer la pratique médicale, le respect des droits des patients n’exclut pas les problèmes. Cela peut créer un découragement. Les droits des patients peuvent enfin être ressentis comme extérieurs à la pratique médicale, comme imposé du dehors, ce qui peut entraîner un effet de rejet. Une étude récente de l’Institut de droit de la santé (IDS) sur la place des sciences sociales dans la formation et la pratique des professions de la santé réalisée en 2017 pour le compte de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales tend pourtant à démontrer le contraire . Il n’y pas d’un côté une médecine basée sur les sciences biomédicales et les sciences naturelles avec une priorité sur les actes techniques et la technologie, et, de l’autre, des disciplines annexes, les sciences humaines et sociales, qui se limiteraient à un rôle de soutien. Une telle dichotomie est loin de la réalité quotidienne des médecins, qui n’ont pas besoin d’être humanisés. Au contraire, la médecine est profondément « humaniste » et le médecin fait un usage élargi et régulier des sciences humaines et sociales, usage qui tend d’ailleurs à augmenter plus il ou elle acquiert de l’expérience et accumule des compétences. Avec l’importance croissante des biotechnologies et la technicisation de la médecine, cette évidence peut parfois passer en deuxième plan. Le débat sur le big data et le développement de la santé personnalisée ne fait qu’entretenir cette fausse impression.
Il s’avère ainsi d’autant plus essentiel de rappeler l’importance des droits des patients dans la relation médecin – patient. Il s’agit bien d’un éternel recommencement. L’habitude, la fatigue, le manque de connaissance et de reconnaissance peuvent amener certains médecins à oublier cette réalité. Il convient donc de revenir régulièrement sur la question, d’insister sur le fait que ces droits sont un gage de sécurité et de qualité dans la fourniture de soins. Loin de remettre en cause la confiance des patients et du public à l’égard des soignants et des médecins, il s’agit au contraire d’insister sur l’humanité qui devrait rejaillir de chaque rencontre médecin – patient, sur la nécessité de favoriser le dialogue, de responsabiliser les uns et les autres. Le défi est de ne jamais considérer comme acquis les droits des patients, mais à chaque nouvelle rencontre, d’y puiser les bases d’une relation solide dans le respect de chacun. Le droit n’a de sens que s’il est appliqué. Cette évidence invite à s’en inspirer davantage, non pas par obligation, mais tout simplement car cela relève des règles de l’art et des bonnes pratiques médicales.
Source :
SMN News, n°93, Printemps 2018 : http://www.snm.ch/images/documents/snm_news/93_snmnews.pdf


 Médecins de garde
Médecins de garde
 Infographies patients
Infographies patients