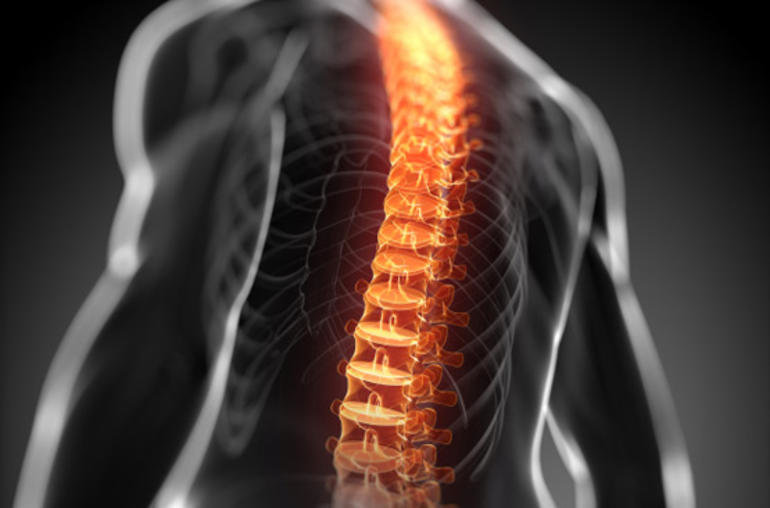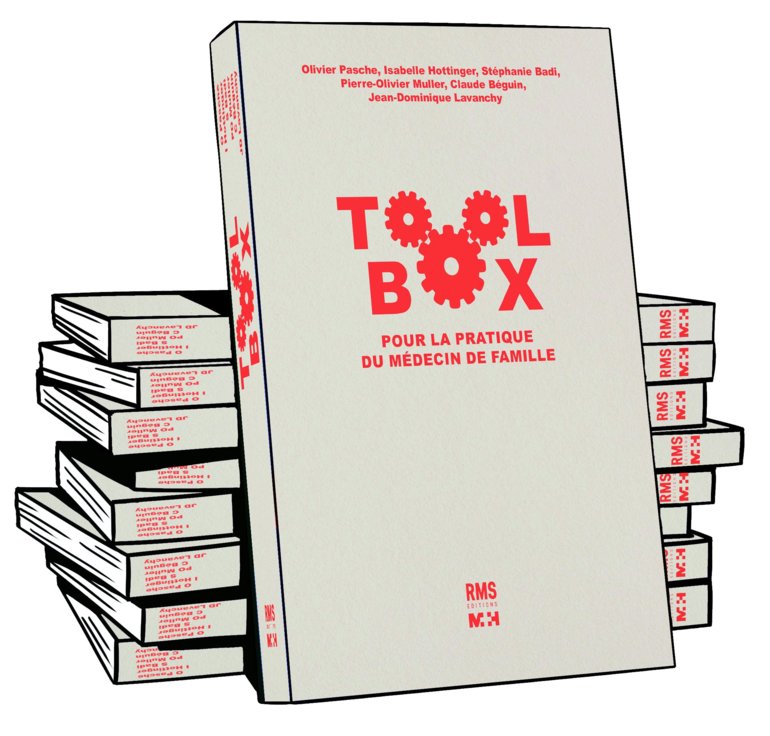La médecine se trouve aujourd’hui au centre d’un champ de tension…
On observe, d’une part, une tendance à la privatisation, comme le montre la récente acquisition de Mediclinic – détenteur des cliniques Hirslanden en Suisse – par la multinationale Mediterranean Shipping Company (MSC) et le milliardaire Johann Rupert, propriétaire du groupe de luxe Richemont. On parle tout de même d’une offre estimée à 4,2 milliards de francs ! Cette annonce prouve que le monde de l’économie s’intéresse aujourd’hui très fortement à la médecine et à la santé. Cependant, d’un autre côté, on a l’impression que le corps médical est de plus en plus étatisé, avec notamment l’introduction de la clause du besoin qui dénote un contrôle supplémentaire de l’État, puisque cet outil instauré par les Chambres fédérales pour freiner la hausse des coûts de la santé autorise les cantons à limiter l’offre médicale à charge de l’assurance-maladie obligatoire (AOS). Des quotas peuvent être fixés pour réguler l’ouverture de nouveaux cabinets. Les cantons disposent d’un délai au 1er juillet 2023 pour mettre en place ce nouvel outil de contrôle. Ce dernier peut porter sur une ou plusieurs spécialités, ou certaines régions.
D’après vous, vers quel modèle se dirige-t-on ?
Nous allons vers une médecine à deux vitesses et je ne pense pas qu’une marche arrière soit possible. Ce n’est probablement pas une volonté politique claire, puisque le discours officiel défend une valorisation de la médecine de famille et de la relation avec les patients, mais les directions prises par les gouvernements, les réformes qu’ils entreprennent, vont dans le sens d’une médecine à deux vitesses. On peut déjà constater les effets de cette politique, en Allemagne et en France notamment. D’une manière générale, on s’achemine vers un modèle où les patients qui bénéficient d’une assurance complémentaire auront un accès privilégié aux soins, tandis que les autres devront patienter pour obtenir un rendez-vous, un traitement ou une prise en charge. Le problème est que les débats sur l’accès et la qualité des soins ne sont pas menés jusqu’au bout, alors même que la Suisse figure en tête des comparaisons internationales en la matière. Prenez l’exemple de l’intégration dans la LAMal des prestations effectuées par les psychologues psychothérapeutes FSP. On a résolu une question de facturation, mais la facturation n’est pas tout. Comme par le passé, les médecins de famille vont être amenés à soigner des patients qui présentent des problèmes psychiques. Dans certains cas, ils décideront de les adresser à un psychologue psychothérapeute FSP. Mais, en cas de décompensation, la question d’une prise en charge par un psychiatre se posera. Or, des traitements auront peut-être déjà été prescrits. Voilà pourquoi je pense que la solution qui a été trouvée apporte davantage de questions que de réponses du point de vue du parcours patient. Dans les discussions sur le remboursement des prestations et des coûts de la santé en général, il faudrait s’intéresser en premier lieu à cette question de fond.
Quid de la pénurie de personnel soignant dans un tel contexte ?
Le manque d’effectifs est intimement lié au mal-être des soignants. Bien sûr, d’autres secteurs souffrent d’une pénurie de main-d’œuvre, comme l’hôtellerie-restauration, les transports et l’informatique par exemple. Mais dans le domaine de la santé, on note une exacerbation de la perte de sens du métier et ce sentiment de mal-être contribue à la pénurie de personnel. À titre d’exemple, avant même la pandémie de coronavirus, cette question a été retenue deux années de suite, en 2018 et en 2019, pour les débats des États généraux de la santé du canton de Genève. C’est un signe. À ce propos, je mentionnerai également le réseau ReMed, mis sur pied par la Fédération des médecins suisses (FMH) pour venir en aide aux médecins en situation de surcharge de travail, de burnout ou de dépendance. L’usure professionnelle des médecins est un problème qui prend une ampleur inquiétante.
Comment les jeunes médecins réagissent-ils ?
Ils sont en quête de sens, animés par des questions sur le cœur du métier. Ils s’interrogent sur des valeurs profondes en lien avec le respect, l’équité et l’égalité, la protection de l’environnement et la durabilité, entre autres. Les nouvelles générations de médecins sont porteuses d’espoir et d’avenir, via les prises de conscience qu’elles sont susceptibles d’entraîner au sein de la communauté médicale. Elles ont le désir de venir en aide aux autres – qui est la vocation première de tout médecin – et sont concernées par le monde qu’elles laisseront aux générations suivantes. Elles sont capables de parler plus ouvertement du harcèlement au travail, du sexisme institutionnel, de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Le tabou sur ce genre de sujets est en train de tomber. Dans ce contexte, la question du projet de famille s’avère particulièrement délicate. J’ai récemment assisté à une présentation sur la réforme des études de médecine. Au milieu d’une assemblée de professionnels de la santé, une jeune interne s’est levée pour dire que tout le monde parlait de son avenir mais que personne ne lui donnait l’impression de maîtriser le sujet. Je trouve que ce cri du cœur devrait nous faire réfléchir.


 Médecins de garde
Médecins de garde
 Infographies patients
Infographies patients